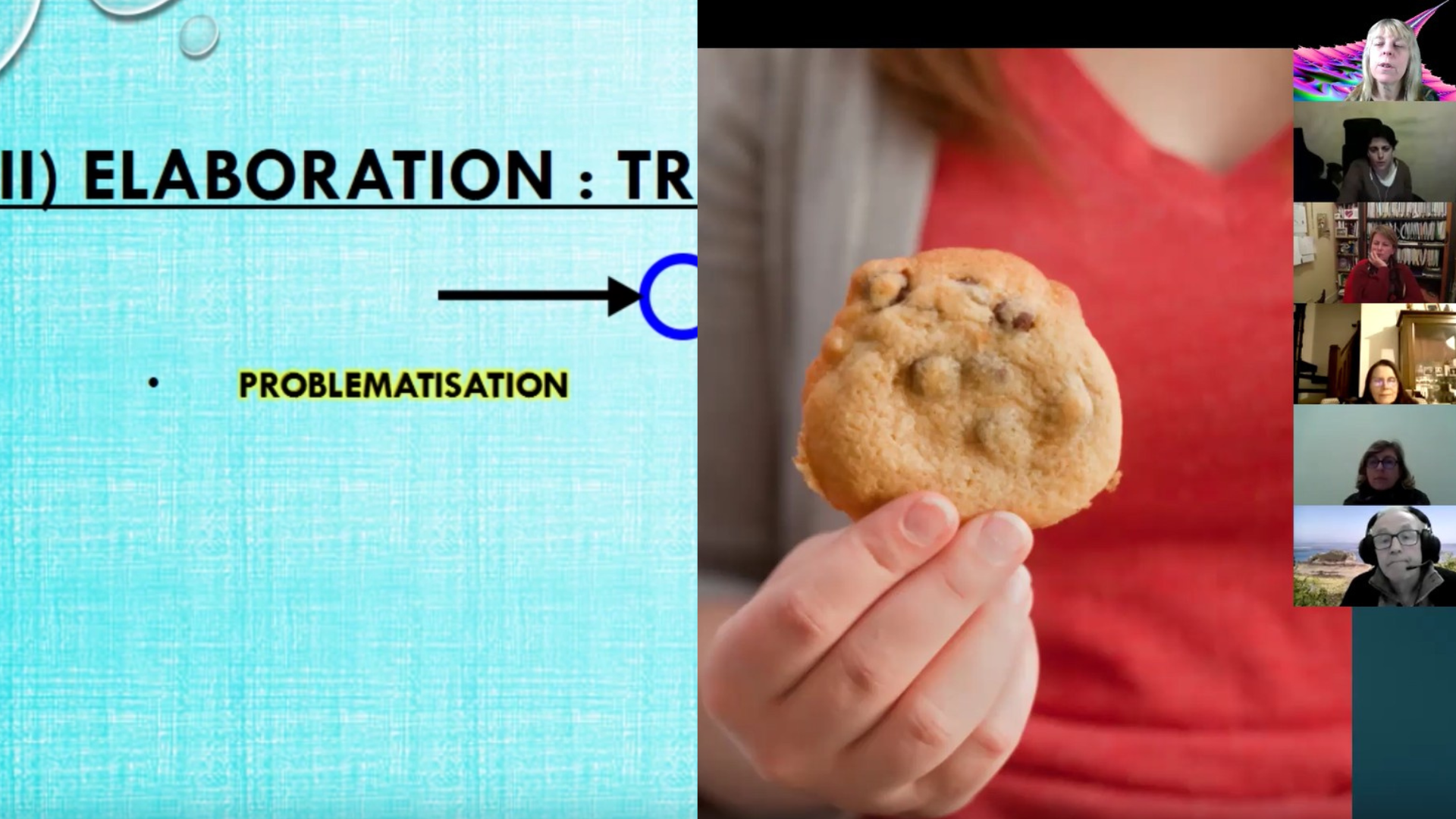Quelles formations pour être pédagogue ? Dans cet article, Stella Kaloudis, formatrice, présente son avis détaillé sur les deux formations phares de l’institut Upbraining, spécialisé dans le développement de l’apprentissage : Initial et Propulsion. Upbraining Initial : la base de toute pédagogie La formation Upbraining Initial est à la base de toute pédagogie dans la mesure où elle propose aux stagiaires de découvrir comment le raisonnement se construit chez les personnes . Les stagiaires peuvent ainsi apprendre et comprendre comment maximiser leur implication auprès des personnes (peut-être pour les enfants ou des personnes en grande difficulté) de façon à maximiser la découverte des apprentissages dans la vie de tous les jours… ce qui aura un effet dans la suite de la scolarité. Les bases des critères de médiation et l’apprentissage de comment mettre en place les fonctions cognitives nécessaires forment les fondations du développement du potentiel de la personne. Dans la formation, beaucoup de ressources sont partagées et les suivis mensuels en ligne permettent de rassembler les stagiaires qui débutent avec les plus chevronnés, de se retrouver pour partager leurs expériences et obtenir des réponses en direct à leurs questions. UPbraining initial devrait être « LE MUST » pour tous les parents, les enseignants ou accompagnants qui veulent donner aux personnes dont ils ont la charge le meilleur départ possible dans la vie… voire même opérer une re-médiation optimale lorsqu’ils ont besoin d’un coup de pouce à n’importe quel moment de la vie. La formation existe en ligne ou bien en présentiel, donc il est possible de choisir ce qui convient le mieux aux stagiaires potentiels. Upbraining Propulsion : un incontournable pour les pédagogues Upbraining Propulsion est une formation puissante qui permet de balayer les grands aspects de la pédagogie dont chaque pédagogue devrait être équipé avant d’exercer auprès des personnes. La formation propose des méthodes de préparations de séances assez exhaustives où chacun des stagiaires va pouvoir exprimer sa créativité autour de matrices soit linéaires, soit sous forme de carte mentale. Cette formation met à disposition une base de données, riche et évolutive, dans laquelle nous pouvons puiser des supports et des ressources. L’accompagnement se fait dans la durée au travers des Zooms hebdomadaires, où les stagiaires peuvent alors soumettre leurs questions et obtenir des réponses de la part des formatrices, ou des partages d’expériences de la part des autres personnes. Propulsion devrait être un incontournable pour toutes personnes souhaitant se perfectionner dans la transmission pédagogique. Article par Stella Kaloudis
Auteur/autrice : Stella Kaloudis
Etude de cas d’une séance avec un métapédagogue
Etude de cas d’une séance avec un métapédagogue Un petit garçon de 9 ans vient me voir, accompagné de sa maman, et raconte que tout va bien à l’école. “Ah oui ? Et pourquoi es-tu là, alors ?”, je lui demande. “JE NE SAIS PAS !”, il me répond, nonchalant. Cette réponse m’interpelle. Sa mère m’avait contactée car il manquait de concentration, en classe comme à la maison. Ses notes et ses évaluations étaient basses, et il était souvent puni d’heures de colle pour “éparpillement”. Aussitôt, je propose à l’enfant de se débarrasser de cette pensée “Je ne sais pas” en l’écrivant sur un post-it, et de consciemment jeter ce post-it à la poubelle. Sitôt fait, je lui dis : “Maintenant, on n’en parle plus, on ne le dit plus, OK ?” Il rigole en approbation. Vouloir savoir, vouloir comprendre : la base de la métapédagogie Ce qui peut paraître comme une introduction mignonne à nos séances ensemble est loin d’être anodin : ma phrase annonçait la couleur de ce sur quoi on allait travailler ensemble après. En effet, quelle que soit la situation, mon but est que l’enfant ne puisse plus dire “Je ne sais pas”, mais sache plutôt comment trouver les informations qui lui manquent pour obtenir la réponse. Pour savoir, on a besoin de vouloir savoir, d’aller chercher la réponse, de demander à quelqu’un, et encore mieux, de trouver dans sa tête une façon de répondre différente. Il ne s’agit pas non plus de faire Essai-Erreur, mais bien de tenter de résoudre une difficulté en se posant soi-même des questions. C’est cela qui fait la richesse de la métacognition : se poser des questions. Les bonnes questions ! Il est important de savoir décortiquer ce qui ne va pas, ce qui empêche d’apprendre, et d’avoir la curiosité, l’envie de répondre autre chose que : “JE NE SAIS PAS”. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser pour avancer ? Le jeu pour explorer les processus cognitifs En tant que métapédagogue, ma première fonction est de mettre en évidence les carences de raisonnement dans l’esprit de l’enfant, puis d’y remédier. Dans mes séances, je travaille avec une variété de jeux qui me servent de support pédagogique en aidant l’enfant à se détendre et à s’exprimer librement. En le faisant réfléchir à voix haute et en lui posant les bonnes questions par rapport au défi présenté, je peux ainsi observer en direct son comportement cognitif à plusieurs niveaux : Ainsi, sur une base complète de 29 processus (fonctions cognitives), je peux détecter un ou plusieurs points d’entrée pour effectuer une remédiation. Exemple d’une séance métapédagogique Dans le cas de ce petit garçon de 9 ans, je lui ai donné un jeu en apparence simple : un plateau de 4 cases * 4 cases, avec des plots de couleurs et de formes différentes. Il devait déplacer les plots pour créer des lignes soit de la même couleur, soit de la même forme. A la fin de l’activité, je l’entends dire fièrement “J’ai fini !”, le sourire aux lèvres. Au lieu de le féliciter simplement comme on le ferait dans l’enseignement traditionnel, je lui dis : “Je vois que tu penses avoir fini, et en même temps je te propose de VÉRIFIER ce que tu as fait… juste au cas où !” Cela ne rate pas : il vérifie, ligne après ligne… et trouve que deux formes identiques sont l’une à côté de l’autre ! Il les change rapidement, et est tout content d’avoir trouvé son erreur. “Alors, qu’est-ce que tu viens d’apprendre ?”, je lui demande. “Qu’il faut toujours vérifier son travail avant de dire qu’on a fini !” “Oui, et pourquoi à ton avis ?” “Pour pouvoir corriger !” “Et donc que vas-tu pouvoir faire à l’école maintenant ?” “Ralentir et vérifier à chaque fois.” “Si c’est bon pour toi, c’est OK pour moi aussi.” Puis nous notons avec sa maman, présente pendant toute la séance, ce “processus” de vérification dans un cahier qui va le suivre à la maison et qui servira de base de suivi pendant la semaine. L’important n’était donc pas de résoudre le jeu, mais d’en déduire des principes qui l’aideraient ensuite à l’école comme à la maison ! En général, j’identifie 3 processus à la fin de chaque séance sur lesquels l’enfant et ses parents pourront travailler pendant la semaine, à l’école comme à la maison. J’inclus toujours les parents, car ils jouent un rôle clé pour accompagner la remédiation cognitive en-dehors de notre session. Chacun a la responsabilité du suivi. Résultat : une meilleure autonomie dans l’apprentissage La semaine suivante, lorsque le petit garçon est revenu me voir, je lui demande juste : “Alors, sur quoi as-tu porté ton attention en classe cette semaine ?” Sans réfléchir, il dit fièrement : “J’ai vérifié mon travail !”, avec une telle banane sur son visage ! Au fur et à mesure de nos sessions, sa maman m’a rapporté que non seulement ses notes se sont améliorées, mais il a aussi grandement amélioré sa confiance en lui, son estime de soi, et il a désormais une bien meilleure gestion de ses apprentissages. J’aime mon travail de métapédagogue car au lieu de simplement donner des cours particuliers, je donne les outils aux apprenants pour qu’ils gèrent eux-même leur apprentissage d’une meilleure façon. Ils développent leur autonomie et voient leur motivation monter en flèche. C’est ainsi que la métapédagogie crée des apprenants plus autonomes, plus motivés, avec plus de succès ! Vous voulez en savoir plus sur la métapédagogie ? Consultez nos formations. Article par Stella Kaloudis